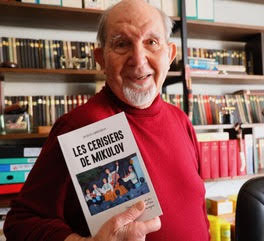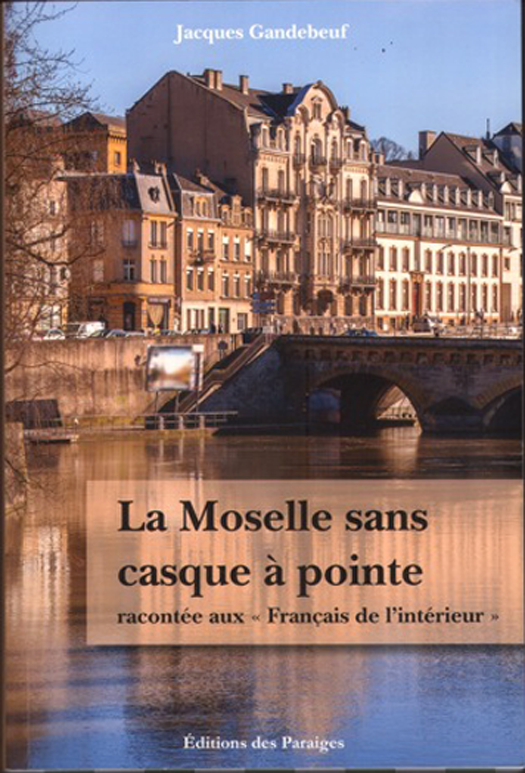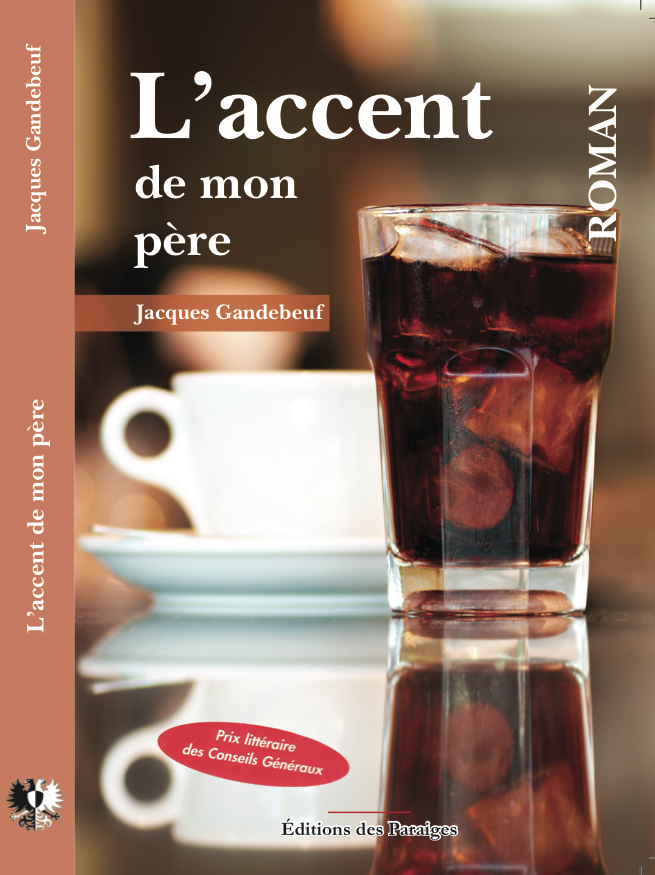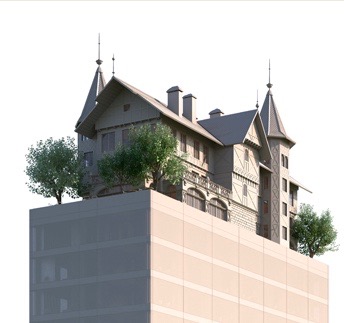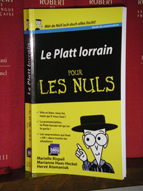L'histoire des "malgré-nous" a comporté, chacun le sait, bien des silences. Des années après leur retour, ils n'osaient pas encore décrire les pièges diaboliques vers lesquels ils avaient été entraînés.
Il suffisait pourtant de connaître le vécu de l'un ou l'autre de ces revenants, d'entendre une vérité sortie de sa propre bouche, pour comprendre, à la Libération, l'image qui lui collait à la peau: celle de paria condamné au silence.
Prenons le cas des réactions dans l'armée américaine durant l'hiver et le printemps 1945. Par gratitude envers les nombreux GI's morts en Lorraine, il serait certes inélégant de critiquer nos libérateurs. Mais les frontaliers n'ont pas oublié les incompréhensions absurdes qui avaient parfois terni l'arrivée des premiers fantassins aux portes des caves bombardées où se terraient les civils. Pour faire bref, les Américains, déjà connus pour leur ignorance de tout ce qui n'est pas l'Amérique, avaient du mal à comprendre qu'ils libéraient du joug allemand des villages dont le nom était germanique. On imagine que les "malgré-nous" planqués dans les fermes depuis leur désertion y regardaient à deux fois avant de sortir pour les accueillir. Devenus peu bavards, par prudence atavique, ils se gardèrent plutôt de révéler, après 1945, la désillution qu'avaient connue des centaines d'entre eux à propos de leurs "sauveurs". Mal placés à l'époque pour donner des leçons, ils savaient qu’on n’aurait pas compris leurs critiques, ce qui aurait eu pour seul résultat de les "bochiser" une fois de plus.
Et pourtant... Nicolas Gambs, l’un des 30.000 incorporés mosellans, a raconté sa "libération" très particulière. En décembre 1944, il se cachait depuis un an, après avoir déserté la Wehrmacht. Dans Rimling, son village du Bitcherland, à quelques centaines de mètres de la frontière allemande, les insoumis et les déserteurs étaient si nombreux à guetter l’arrivée des Américains que toutes les granges en restaient fébriles. On rêvait chaque nuit, d’une ferme à l’autre, en imaginant le ronflement de la première jeep, en haut du virage.
L’engin déboucha enfin et une quarantaine de "malgré-nous" convergèrent en même temps sur la route... Dégringolant des échelles, ou se laissant glisser le long des meules, ces jeunes qui avaient, depuis tant de nuits, rasé les murs comme des renards, couraient soudain vers la vie, stupéfaits de se découvrir en si grand nombre, même si, à la barbe des Allemands, leur présence autour du village était un secret de Polichinelle. Ils arrivaient parfois les sabots à la main, pour débouler plus vite. Quelques heures plus tard, une fois passée l'effervescence, tous ces revenants trop naïfs s’était retrouvés alignés contre un mur, avec une mitraillette en guise d'accueil.
Les insoumis, c’est-à-dire ceux qui n’avaient jamais répondu à l’incorporation, avaient été relâchés sans trop d’explication, du bout des lèvres. Essayons de comprendre. C’était déjà beaucoup demander à des caporaux du Kansas. Mais les déserteurs, c’est-à-dire les incorporés de force qui s’étaient enfuis du front russe, ou à l’occasion d’une permission, ceux-là n’avaient pas été relâchés du tout! C’était vraiment trop demander à des sergents de l’Oklahoma.
Plus tard, un gradé américain avait fait subir aux prisonniers interloqués un interrogatoire surréaliste. On peut certes excusercomprendre la méfiance des Américains, qui avaient déjà beaucoup de mal en découvrant qu'en France, les localités nord-mosellanes avaient des noms germaniques.
Mais comment accepter le ton des interrogatoires?
Leur teneur atteint les sommets du crétinisme militaire. Imaginez le gradé américain, et les "malgré-nous inquiets" face à lui... Une page d’anthologie.
"Vous avez refusé de porter l’uniforme allemand?"
- C'est que, vous voyez, mon commandant... Je suis resté caché dans mon village depuis un an..
- OK mon vieux! Ça, je le comprends encore. Mais vous n’aviez pas refusé d’être incorporé?
- A vrai dire... j’aurais bien voulu, mon commandant. Mais ils pouvaient déporter mes parents. Alors j’ai préféré disparaître en sauvant les apparences, à la fin d’une permission.
- Donc vous reconnaissez que vous avez déserté?
- On ne peut pas dire ça comme ça, mon commandant. Car j’en suis fier
- Il n’y a pas de quoi, mon vieux. C’est un crime...
- Un crime? quel crime?
- Un soldat ne doit jamais déserter. Mettez-vous de côté, contre le mur. Au suivant!"
Les "criminels" s’étaient retrouvés embarqués dans un camion.. Ils avaient rejoint d’autres convois, où se trouvaient déjà des masses de prisonniers allemands. A Nancy, on leur avait jeté quelques pierres en passant, hommage furtif des Lorrains du sud aux Lorrains du nord. Les malheureux croyaient encore à quelque méprise. On allait probablement les relâcher au bout de la semaine...
Mais après plusieurs jours de train et de pénibles arrêts en gare, lors desquels de braves cheminots, scandalisés de voir des "chleuhs" oser leur parler français, refusaient de leur donner à boire, les Américains les avaient parqués au camp de Thorée-les-Pins, près de la Flèche, à des centaines de kilomètres de chez eux. D'où le nom de "fléchards" qu'ils se sont donnés depuis.
Harcelés par le froid, torturés par la faim, et soumis par dessus le marché aux brimades de plusieurs milliers de PG allemands dont le nazisme à géométrie variable se sentait alors requinqué par l’offensive de Von Rundstedt dans les Ardennes, nos pauvres Lorrains tombaient des nues.
- "Ach so! C’est vous, bande de salauds? Vous nous avez lâchés, bande de traîtres! Attendez que le vent tourne. On va vous coller contre un mur!" Ils étaient devenus les déserteurs de tout le monde. Pendant cinq mois, plus de 200 Mosellans avaient ainsi croupi dans un enclos, lors d’un hiver qui n’en finissait pas, et sans voir le moindre képi d’officier français à l’horizon. Visiblement, ils n’existaient pour personne. A la fin du printemps, les "fléchards" étaient rentrés chez eux, la tête basse, humiliés à jamais.
J’avais plusieurs fois rencontré Robert Schoeser à la fin des années soixante, à Sarrebourg. Il était journaliste au "Républicain Lorrain" et nous avions sympathisé. On avait bien fini par parler de la guerre, car en Moselle, malgré le peu d’empressement qu’ont les gens à traiter le sujet à fond, il est par contre impossible de ne pas au moins l’effleurer, en face d’une bonne bière. Mais Robert ne m’avait jamais raconté ce qui lui était arrivé. J’ai su, après sa mort, qu’il était un "fléchard", lui aussi! Et j’ai compris son silence.
Essayer d’expliquer une mésaventure pareille à un Français de l’intérieur qui débarquait, c’était probablement au dessus de ses forces... Des miennes aussi... Incapable d’imaginer une absurdité pareille, je lui aurais sans doute répondu qu’à l’époque, les Américains avaient autre chose à faire qu’à trier les vrais Allemands des faux.
Et même, je me connais, j’aurais sûrement ajouté qu’après tout, il était plus prudent du point de vue allié de parquer, pour un court moment, tous leurs prisonniers avec les mêmes initiales dans le dos. Mais avec le recul, j’ai changé d’avis....
Ils n’étaient pas vraîment très futés, les officiers de la Sécurité militaire américaine! Certes, ils devaient avoir leur mentalité, eux-aussi, mais ne pouvaient-ils chercher à comprendre? Alors que dans les ballades de la guerre de Sécession, des chansons que ces soldats courageux avaient tous apprises à l’école, il devait bien en exister une bonne douzaine qui racontaient le déchirement des familles écartelées, entre le Nord et le Sud... "Deux jeunes frères, ils sont partis, vêtu de bleu, vêtu de gris, etc..."
Mais cette histoire des "fléchards", qui la connaît en France? Elle a certes percé dans quelques récits, pratiquement à usage local. Le sujet de l’incorporation forcée restait trop tabou pour qu’on en rajoute encore.
Les "malgré-nous" se sont certes réveillés depuis quelques années. Le poids d’une question banalement classique (j’y vais ou je n’y vais pas? et si j’y vais, que vont-ils faire à mes parents?) est maintenant mieux mesuré par l’opinion française. Au risque de se faire noyauter par des politiciens opportunistes, les associations d’incorporés se sont même risquées, parfois, sur les estrades.
Elles se sont si bien démenées qu’elles ont fini par rendre jalouses d’autres victimes de guerre moins organisées, ce qui est un comble. D'anciens résistants, pas tous, ont de la peine à reconnaître le drame des "malgré-nous". C'est humain. Mais au délà de ces maladresses diverses, on n’a encore jamais lancé un vrai débat philosophique, sur le traumatisme spirituel, n’ayons pas peur du mot, que pouvait subir un conscrit encore tendre, poussé à coups de talon dans un univers de brutes infréquentables?
Sans doute paralysé par le syndrome d’Oradour, où, ne l’oublions pas, les seuls Mosellans concernés, des francophones évacués de 1939, ont péri en 1944 dans l’église, nul psychologue n’a osé mesurer l’angoisse qui peut encore, cinquante ans plus tard, tourmenter certaines consciences.
Non seulement, les "malgré-nous" ont été forcés en temps de guerre d'endosser l'uniforme des soldats qui attaquaient leurs compatriotes, ce qui est crime juridique, mais ils ont aussi pu assister, dans l'Est soviétique, à des opérations barbares auxquels ces tout jeunes hommes, à peine rodés, politiquement ignorants et souvent très croyants, ont peut-être participé. Leur silence, à ce propos, et comme un grand linceul posé sur leur mémoire.