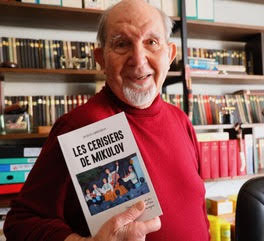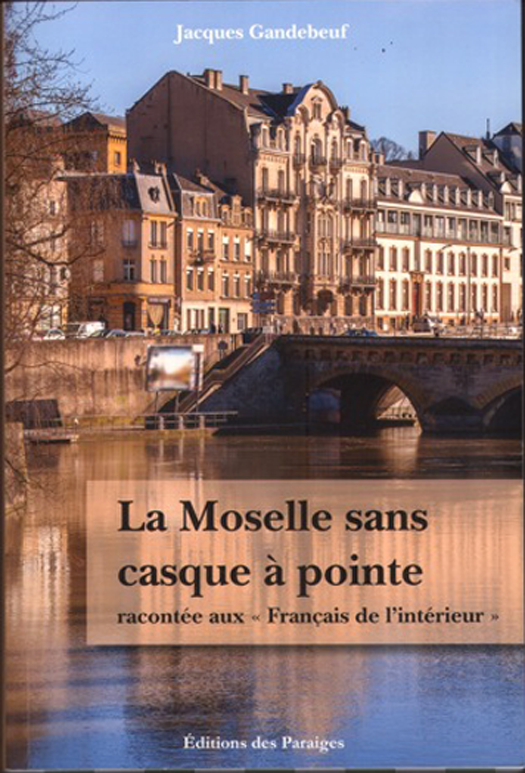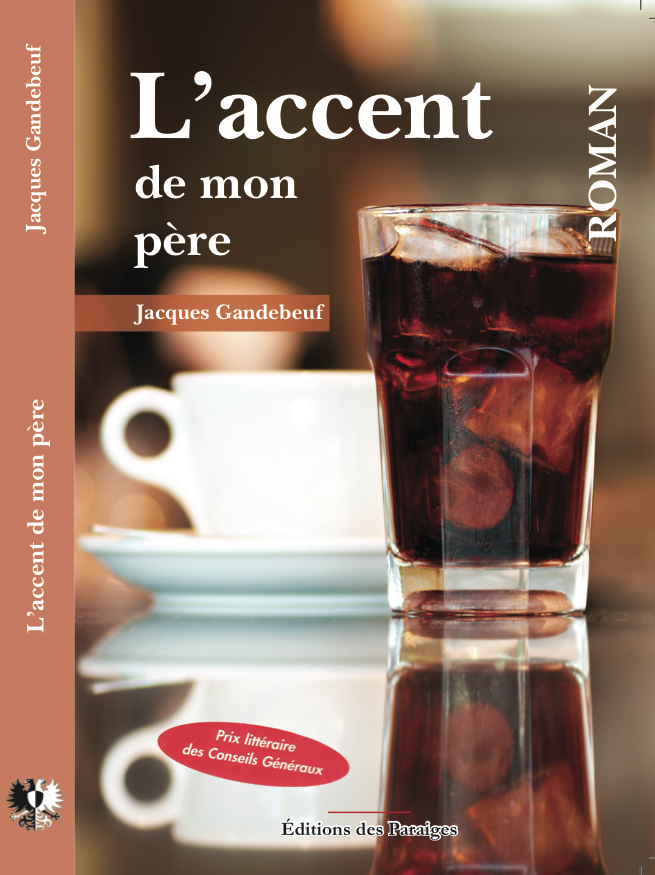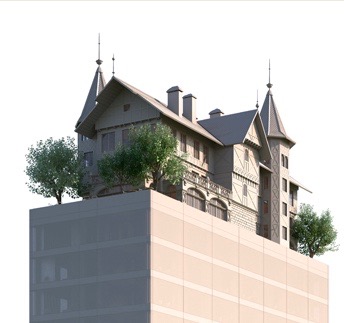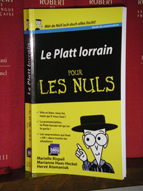Entre 1940 et 1945, tout Mosellan vivait son drame, sans forcément savoir ce qui arrivait à ses voisins. C’est ainsi que, plus tard, chacun eut peur du regard de l’autre. S'ils avaient su se parler quand la paix revint, rien de semblable ne serait arrivé. On aura compris qu'il a existé différentes manières d'être victime.
Avant d'aborder chacun de ces destins, il faut revenir sur celui des Résistants, qui connût de grandes heures en Moselle mais n'eût pas à en faire la preuve. Il suffit de lire les plaques des rues pour savoir que rien n’est oublié.
Des noms restent incrustés dans les mémoires: En Moselle-Ouest, le groupe Mario, Soeur Hélène, la famille Thiam, Ernest Kempnich... et des centaines d’autres en Moselle-Est ou frontalière. Leurs gestes courageux ont été souvent rapportés par les historiens. C'est pourquoi leur statut d'acteur historique échappe à l'objet de notre recherche. Nous cherchons à comprendre le blocage qui empêcha les Mosellans disons ordinaires de raconter leur guerre de peur de devoir subir un questionnement malveillant. Il est évident que l'image des résistants ne se discuta jamais.
Du coup, aux lisières de leur comportement courageux et souvent héroïque, les années ont fini par gommer le souvenir de milliers de réactions plus banales, totalement spontanées, des manières individuelles de résister qui, sans aller jusqu’au courage physique ou mental, traduisaient un refus instinctif de l’ordre nazi. Elles étaient parfois d’une ingénuité pathétique.
On le devine en lisant, par exemple, la prose autoritaire du Gauleiter Bürckel, publiée dans la presse messine en février 1944. Il nous apprend que "dans les annonces nécrologiques de Lorraine, la tournure suivante est très souvent reprise: "Il est mort par amour pour ses parents, afin de leur conserver une patrie."
Bürckel était, à ce qu'on prétend, une brute souvent alcoolisée mais il n'était pas idiot. Cette phrase, dit-il, doit immédiatement disparaître du texte des annonces car il n’existe aucun doute sur sa signification. Elle devra donc être remplacée par l’expression suivante: "Il est mort par amour pour ses parents, pour les protéger, eux et la patrie allemande, du bolchévisme."
On eut aussi des gestes d’un panache incroyable et quasiment suicidaire. Qui se souvient encore d’un certain Pierret, laveur de carreaux à Sarreguemines? "Un beau garçon aux cheveux blonds," d’après les Allemands eux-mêmes. J'ai retrouvé son histoire tragique dans le livre de Dieter Wolfanger "Nazification de la Lorraine mosellane", une somme d'informations fondamentales, édité chez Pierron.
Le problème de ce fier personnage, c’est qu’il ne supportait pas les aboyeurs nazis. Alors, chaque fois qu’ils l’appelaient "Pirett", il répondait "Je m’appelle Pie-rrret", en insistant sur la prononciation. Incorporé de force dans la Wehrmacht, il arriva jusqu’à la caserne dans un uniforme kaki des soldats français de forteresse, avec un gros bâton noueux et un grand béret...
Un sous-officier allemand l’avait apostrophé:
"Was sind das fûr Lumpen?" Qu’est-ce que c’est que cet oripeau?
Pierret lui avait répondu:
"Bas les pattes!" en lui donnant un coup de bâton sur la tête!
On imagine la suite. Vous penserez qu'il l'avait un peu cherchée, mais le geste vaut un coup de chapeau quand même.
Dès sa première permission, retour de l’enfer russe, Pierret refusa de passer en zone libre craignant de compromettre sa vieille mère. Et il repartit vers le front, où il fut tué.
L’oubli de ces milliers de conduites individuelles ne fut pas seulement dû au temps qui passait. Dès les années cinquante, la "guerre froide" empoisonna les cervelles, en divisant, durant des années les résistants eux-mêmes.
Ce chaos ne pouvait qu’encourager les pertes de mémoire. Les conflits d’intérêt s’étaient alors multipliés. Qui avait le plus profité de la guerre? Qui avait été un vrai résistant? Et l'on trouva même des "malgré-nous" qui à leur retour de Tambov, en voulaient plus aux Russes qu'aux Allemands, ce qui traduisait une conscience politique au degré zéro.
A propos des évasions sur le territoire mosellan, on fit parfois dans la médisance. Un petit nombre de loustics peu scrupuleux avaient certes profité de la situation pour s’enrichir aux dépens des évadés qu’ils convoyaient, mais c’est l’ensemble des passeurs qui avait supporté la calomnie. Et comme la plupart d’entre eux, pour échapper au poteau d’exécution, affirmaient systématiquement à la Gestapo qu’ils avaient seulement agi par intérêt, ils noircissaient volontairement leur image... Les Allemands se faisaient évidemment un plaisir de colporter dans les journaux cette apparente cupidité, dont ils n'étaient pas toujours dupes.
Une telle manière de calomnier n’est pas nouvelle. L'effet en est d’autant plus dangereux que beaucoup d’historiens d’aujourd’hui n’ont pas connu l’époque et qu’ils exigent, pour la raconter, de voir des documents qui n’ont jamais existé! Il ne reste alors que les témoignages.
Or depuis quelques années, nous savons qu’un formalisme tâtillon peut justifier tous les révisionnismes. Parce qu’un maquisard survolté aura prétendu en 1945 que les SS ont fusillé sous ses yeux une demi-douzaine de copains, alors qu’il est prouvé soixante ans plus tard qu’ils n’étaient que quatre à se trouver pris dans la nasse, l’historien en déduira, non sans délectation parfois, que ce maquisard est un menteur et que l’exécution n’a pas eu lieu. On a vu ce que cela pouvait donner à propos des chambres à gaz.
Mais voici qu’au bout d’un siècle cruel, la repentance est à la mode... Quelque part, l'opinion n'a pu supporter la vilénie du négationnisme. Elle veut savoir... Juste avant d’entamer les années 2000, les témoins ont ainsi ressenti la nécessité de remettre les compteurs à zéro. Mais attention: soumises à la pression, ces rafales de confessions tardives ne veulent pas dire que l’interprétation de l’Histoire va se moraliser du jour au lendemain. Il existera toujours des mémoires sélectives et nous savons bien que certains repentants d’aujourd’hui ont dû se forcer un peu...
Leur geste médiatisé n’en reste pas moins savoureux puisque, dans le pire des cas, il nous fait deviner qu’ils se sont sentis obligés de demander pardon. Mais pardon pour quoi? Alors là, on est désolé, mais ça ne servirait à rien d’entrer dans les détails. Vous ne voudriez tout de même pas que l’on remue toutes ces horreurs? C’est déjà bien beau qu’on fasse des excuses...
L’hypocrisie vient d’inventer la repentance virtuelle, c’est-à-dire une demande de pardon globale, pour des crimes à propos desquels on s’est toujours prétendu innocent.
Les âmes simples en seront choquées. Elles désapprouvent que l’on veuille ainsi laver, d’un seul coup d’arrosoir, des milliers de plates-bandes individuelles. Elles savent bien que le mea culpa déversé en pluie fine, n’a vraiment rien à voir avec la contrition. La repentance n’est qu’un exercice de communication comme un autre. Sa prolifération soudaine, plus de cinquante années après les évènements, n’est que le fruit de l’objectivité rabougrie de trop d’historiens. Ils avaient tendance à chercher les faits comme on va aux truffes, sans creuser le terroir environnant.
Par horreur de l’anecdote, ils nous avaient rédigé longtemps de la chronique en "noir et blanc". Regardez la majorité des livres sur la dernière guerre... Ils continuent de nous disséquer des stratégies, au lieu de peindre le stress des populations bousculées.
Des spécialistes sauront flécher le parcours de douze bataillons, sans se tromper sur l’âge des capitaines. Mais ils ne vont pas trop questionner leur voisin de palier pour savoir ce qu’il a enduré.
Une approche historique plus moderne a certes permis de bousculer ces manies, mais beaucoup d’événements nous restent encore, aujourd’hui, décantés de leur vibration humaine. Nous commençons tout juste à reconstituer les ambiances civiles. Déjà, les historiens s'inquiètent. Ils disent qu'un témoignage oral ne vaut rien.
Cela se discute. Admettons que sur 200 récits, une bonne douzaine de ces témoins aient dramatisé la vérité, leurs auteurs s’étant trouvés incapables de purger leur histoire de toute émotion, admettons qu’une autre douzaine d'entre eux aient enjolivé la réalité, ayant fini par évacuer, sous l’effet d’un processus mental bien connu, ce que leur insconscient refusait de garder en mémoire. Admettons même que certains d’entre eux aient sciemment gommé des détails gênants. Et alors? Comme l’a écrit Primo Levi, les survivants ne sont jamais les vrais témoins. Leur parole est forcément relative.
Mais leur honneteté n’est pas suspecte. Quand elle oublie un événement, nul ne peut dire pour quelle raison. Serait-ce le peu d’intérêt, la fatigue cérébrale, l’étourderie, la mauvaise conscience ou autre chose? Mystère... Quand, au contraire, elle se souvient, c’est que le dit événement était assez fort pour résister au temps.
C’est peut-être un paradoxe, mais plus l’anecdote est banale, moins elle a de chance d’être inventée! Quand une Mosellane expulsée raconte, avec cinquante-sept de retard, que son village au complet a chanté devant les Allemands le "Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine", on se force encore à douter car la carte postale est trop belle. Il restera toujours des gens qui n’ont aucune envie de chanter dans ces cas-là...
Mais quand notre jeune paysanne (à l'époque) affirme qu’elle a perdu un sabot en courant vers l’autobus, on est quasiment certain qu’elle dit vrai. Ce genre de détail ne s’invente pas.
Le destin de la pauvre Moselle est tellement compliqué, du fait des souffrances corporelles, des morts brutales, des annexions schyzophréniques, des humiliations intimes et des bouleversements familiaux, qu’il ressemble à une poupée gigogne. Quand on ouvre la poupée Moselle, on trouve une poupée linguistique mais aussi une poupée "malgré-elle" et encore une poupée chassée de chez elle et encore beaucoup d'autres à l’infini... Dis-moi quel âge tu avais en 1939 et le nom de ton village, et je te dirai ce qui t'est arrivé en 1940... Toutes les poupées ont la mêmes cicatrice sur le ventre.
C’est pourquoi, au lieu d’identifier ses blessures, le Lorrain des frontières s’est si longtemps résigné à contempler la singularité spiraloïde de son nombril, en se répétant qu’il était vraiment un cocu de l’histoire.